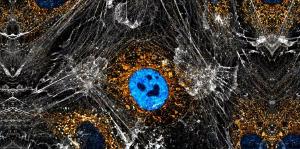On l’appelle « la ville du quart d’heure ». C’est un idéal d’urbanisme qui permettrait aux habitants et usagers de la ville de ne pas avoir à se déplacer plus de quinze minutes à pied pour la plupart de leurs besoins. Ce modèle urbain a pour ambition d’apporter une contribution essentielle aux stratégies de transition vers une ville postcarbone, en réduisant les ressources énergétiques nécessaires à la mobilité. Il concourt surtout à rendre nos vies plus agréables, nos villes plus conviviales et inclusives, soit autant de contreparties essentielles à tout effort de sobriété sur les ressources.
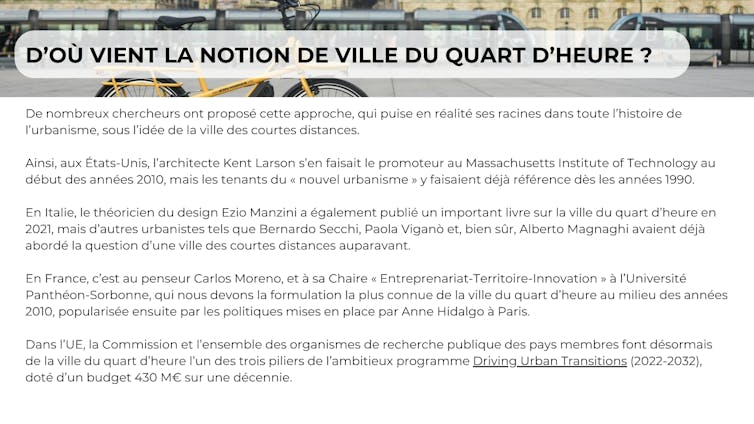
Des villes européennes ont déjà mis en œuvre des politiques de ville du quart d’heure avec un certain succès, comme Paris et Barcelone. Dans ces villes, l’accent a été mis sur la transformation des lieux existants dans chaque quartier pour permettre une pluralité d’usages tout le long de la journée. Moyennant également une adaptation de l’espace public pour une plus grande convivialité piétonne et cyclable, en réduisant la place de la voiture, Paris et Barcelone ont pu bénéficier de l’avantage de formes urbaines compactes déjà présentes.
Les enjeux du périurbain
Cependant, la transition vers une ville des courtes distances est beaucoup plus difficile dans le périurbain d’après-guerre, dépendant de l’automobile et aux formes urbaines moins propices aux piétons. Les politiques appliquées avec succès dans les centres-villes pourraient même exacerber les tensions entre les centres métropolitains en cours de gentrification, parés de toutes les qualités, et les périphéries ou espaces périurbains laissés pour compte, contribuant à la polarisation de nos sociétés mise en avant par le géographe Christophe Guilluy.
Pour l’économiste américain Edward Glaeser, on contribuerait également à saper l’unité et la cohésion fonctionnelle de l’espace urbain, par exemple en tant que marché unique de l’emploi. La ville-centre du quart d’heure resterait en tous cas minoritaire, Paris intra muros ne représentant que 2 millions d’habitants sur les 11 millions de la métropole francilienne.

Mais cette dualité est-elle une fatalité ? Pas nécessairement. Tâchons donc de voir ce qui pourrait permettre plus de proximité dans le périurbain, qui reste la réalité majoritaire de l’urbanisation contemporaine.
Une définition plus précise de la ville du quart d’heure est d’abord nécessaire.
De manière générale, il s’agit d’une ville qui permet de faire bénéficier à ses habitants et à ses usagers, où qu’ils se trouvent dans l’espace urbain, de la proximité immédiate à pied d’un maximum de ressources. Il ne s’agit pas d’une ville sans automobiles, ce qui serait inconcevable pour une grande agglomération du XXIe siècle, mais d’une ville multimodale conçue autour des besoins du piéton. Ce dernier doit pouvoir utiliser aisément l’espace urbain et éventuellement recourir au vélo ou aux transports en commun pour aller plus loin. Cependant, et tout particulièrement dans le périurbain, une part de mobilité automobile restera nécessaire, son rôle devra cependant être alors réduit et redéfini. Cette réduction de la prépondérance automobile constitue à la fois une condition et un résultat de la ville des courtes distances dans le périurbain, nécessitant des changements progressifs.
Lever un malentendu et corriger une erreur conceptuelle
Une fois cette définition posée, il convient d’éliminer d’abord un malentendu et ensuite une erreur dans la manière de concevoir son implémentation pratique.
Le malentendu consiste à considérer le déplacement domicile-travail comme étant central dans la réalisation de la ville des courtes distances. Vivre près de son lieu de travail peut être encouragé de différentes manières, mais cela ne sera jamais un objectif réaliste pour la majorité des habitants d’une métropole du XXIe siècle, comme l’avait déjà souligné l’urbaniste français Marc Wiel ou, plus récemment, Edward Glaeser cité plus haut.
Par ailleurs, même s’il s’agit de déplacements souvent longs et concentrés aux heures de pointe, les navettes domicile-travail ne représentent que 17 % des trajets effectués par les Français, selon l’Enquête nationale sur la mobilité des personnes de 2019. De fait, la très grande majorité des déplacements est désormais liée à la visite de commerces, services et loisirs (56 %) auxquels on ajoutera la fréquentation des lieux d’étude et de formation (9 %). Depuis la pandémie, le recours accru au télétravail pourrait avoir contribué à réduire encore cette proportion. Ainsi, il reste plus des quatre cinquièmes de notre mobilité sur lesquels une politique cohérente de ville des courtes distances peut jouer un rôle pour promouvoir la marche.
La principale erreur consiste alors à aborder le problème uniquement sous l’angle du rapprochement des fonctions : logements, lieux de travail (avec la mise en garde évoquée avant), commerces et services divers. Cette vision, dominante dans la pratique courante, notamment celle prônée par Carlos Moreno, néglige un aspect fondamental. Comme l’ont montré plusieurs chercheurs (Cyrille Genre-Grandpierre et Jean-Christophe Foltête en 2003, Sonia Lavadinho et Giuseppe Pini en 2005, Florence Huguenin-Richard en 2018 sur ce même journal), le simple rapprochement des fonctions ne suffit ni à induire un changement de comportements vers les modes doux (marche, vélo) ni à garantir la convivialité de l’espace urbain, qui est pourtant indispensable pour promouvoir ces mobilités.
En d’autres termes, le rapprochement des fonctions n’incite pas un automobiliste à devenir piéton si l’espace urbain reste hostile à la marche.
Vers une nouvelle vision : l’espace public comme ressource centrale
Dans ce contexte, avec mes collègues urbanistes Meta Berghauser Pont en Suède, Valerio Cutini en Italie et Angelika Psenner en Autriche, je propose une nouvelle vision par le projet de recherche EMC2 – The Evolutive Meshed Compact City, financé par le programme DUT.
Nous identifions comme première ressource, à mettre à courte distance de chaque lieu de vie ou de travail, non pas une fonction spécifique, mais ce qui fait réellement « ville » et manque souvent dans le périurbain, soit un espace public convivial et animé, capable de catalyser toutes les fonctions habituellement associées à la ville du quart d’heure (commerces, services, etc.).
Cependant, une grande agglomération ne peut pas fonctionner en tant qu’archipel de villages urbains autonomes structurés autour de leurs espaces centraux. Les chercheurs, à partir des pionniers comme l’architecte anglo-américain Christopher Alexander jusqu’à Bill Hillier, fondateur de l’école de la syntaxe spatiale à l’University College de Londres dans les années 1980, montrent que les espaces publics doivent constituer un réseau ininterrompu, capable de distribuer la centralité à toutes les échelles de l’espace urbain, y compris dans ses périphéries et son périurbain. S’ils restent des petits clusters de fonctions isolés, les centralités urbaines sont vouées à l’échec : seulement des flux de passage constants entre elles peuvent assurer leur survie et leur développement dans le temps. La mixité des activités est également importante, comme le soulignait dès les années 1960 l’urbaniste américaine Jane Jacobs, des fréquentations croisées bénéficiant à l’ensemble d’entre elles.
Du lundi au vendredi + le dimanche, recevez gratuitement les analyses et décryptages de nos experts pour un autre regard sur l’actualité. Abonnez-vous dès aujourd’hui !
Le rôle du maillage des rues principales et son adaptation au périurbain
On voit ainsi émerger progressivement la solution que nous préconisons pour la ville des courtes distances : au lieu d’un archipel de petits clusters, un réseau, le plus maillé possible, de rues principales concentrant services et commerces, conviviales, accueillantes pour les piétons aussi bien lors de leurs déplacements que lors de leurs arrêts. Ces rues doivent être reliées entre elles et avec d’autres espaces publics (places, jardins, parcs), afin de mailler efficacement l’espace. C’était le modèle de la plupart des centres urbains français et européens, perdu dans la période d’après-guerre lorsque la vision moderniste de séparation spatiale des fonctions et de création de clusters indépendants s’est imposée dans la conception des espaces urbains.
Cependant, ce maillage doit s’adapter aux réalités urbaines concrètes et variées. Les recherches montrent que dans les villes compactes traditionnelles, les rues principales commerçantes sont idéalement espacées de 400 mètres environ. Dans le périurbain, ce maillage peut être élargi (1000 à 1500 mètres) pour s’ajuster aux faibles densités de population et d’emplois, tout en assurant la viabilité économique des services et commerces de proximité. Même si des politiques de densification ciblées autour de ces axes sont envisageables, il est crucial que l’urbanisme d’aujourd’hui propose des solutions adaptées aux faibles densités périurbaines. Dans un contexte de faible croissance démographique, ces zones continueront à représenter une part prépondérante de l’urbanisation européenne au cours des prochaines décennies.
Sortir de la vision de l’urbaniste démiurge
Deux résultats importants des recherches récentes doivent encore être intégrés à cette réflexion
D’abord, contrairement à une certaine vision de l’urbaniste démiurge, encore présente dans la communauté de la ville du quart d’heure, on ne peut pas décréter où les fonctions urbaines s’installeront, en particulier celles qui obéissent à une logique de marché, notamment les commerces. On peut seulement accompagner leur installation, et la création d’espaces publics conviviaux joue un rôle décisif à cet égard.
Ensuite, il est important de souligner que toute rue ne peut pas devenir une rue principale commerçante (même si toute rue peut devenir plus conviviale pour le piéton). Une rue principale requiert plusieurs caractéristiques spécifiques : des propriétés intrinsèques liées à l’aménagement de l’espace public (qualité des trottoirs, présence d’une canopée végétale, mobilier urbain), des propriétés morphologiques des bâtiments qui l’entourent (disposition des bâtiments, ouverture des façades) et, surtout, des caractéristiques découlant du positionnement relatif de la rue dans le réseau urbain (connectivité, rôle de passage, etc.).
Le projet EMC2 : le potentiel pour la ville du quart d’heure dans le périurbain européen
Le projet européen EMC2, un partenariat impliquant le laboratoire ESPACE, l’Agence d’urbanisme azuréenne et l’Agence de développement et d’urbanisme de Lille Métropole en France, ainsi que des partenaires en Autriche, en Italie et en Suède, explore précisément ce modèle urbain.
L’objectif est de tester la capacité des routes de connexion qui sillonnent les espaces périurbains européens à se transformer en rues principales interconnectées, conviviales pour les piétons, et accueillant une grande variété de commerces et services. Ces rues principales devront également intégrer des fonctionnalités supplémentaires, telles que l’accès à des réseaux de mobilité à plus grande échelle et à la trame verte et bleue des corridors écologiques métropolitains.
En complément, des analyses approfondies sont menées dans des zones ateliers spécifiques où l’on peut déjà observer des centralités actives le long de ces routes périurbaines, par exemple à Drap dans la périurbain niçois ou à Seclin dans le périurbain lillois. Ces études visent à comprendre les conditions de réussite de ces espaces en tant que lieux conviviaux pour les piétons et les cyclistes.
Par l’intermédiaire d’une collaboration étroite avec les partenaires locaux, le projet EMC2 produira des recommandations adaptées aux spécificités de chaque territoire étudié, mais suffisamment généralisables pour servir de guide à la définition de politiques de ville du quart d’heure dans d’autres espaces périurbains européens. L’objectif ultime est d’identifier des solutions pragmatiques pour adapter ce concept aux réalités du périurbain métropolitain, tout en prenant en compte les défis morphologiques, économiques et sociaux propres à ces territoires.![]()
Giovanni Fusco, Directeur de recherche CNRS en géographie urbaine et urbanisme, chercheur au laboratoire Espace (Université Côte d’Azur, CNRS, AMU, AU)
Cet article est republié à partir de The Conversation sous licence Creative Commons. Lire l’article original.
THE CONVERSATION
Université Côte d’Azur, par son service Science et Société, a adhéré depuis janvier 2022 au média d’actualité en ligne « The conversation ». L’objectif est de mettre en valeur les travaux de nos équipes de recherche au service d’une information éclairée et fiable qui participe au débat citoyen.
The Conversation est un média en ligne et une association à but non lucratif. Son modèle de collaboration entre experts et journalistes est unique : partager le savoir, en faisant entendre la voix des chercheuses et chercheurs dans le débat citoyen, éclairer l'actualité par de l'expertise fiable, fondée sur des recherches.
theconversation.com