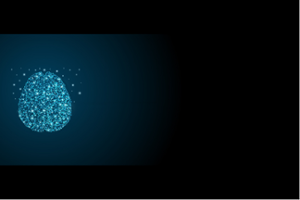UCA News donne la parole aux doctorants, sous un format libre. Pour cette édition, Yan-Erick Fajon nous explique pourquoi il se passionne pour la figure du juge criminel au temps des lumières
Une justice en crise n’est elle pas le reflet d’un régime politique devenu un colosse aux pieds d’argile ?
En effet, la justice criminelle est celle par laquelle chaque citoyen se sent le plus concerné car elle touche le pacte social. Ainsi, chaque citoyen se réfère à la justice criminelle comme prérogative du pouvoir politique.
Or, de ce point de vue, une question fondamentale reste en suspens pour l’historien. C’est celle de la représentation du juge criminel de l’Ancien Régime par les philosophes des Lumières et l’influence que cela eut sur les révolutionnaires de 1789. Autrement dit, la question est la suivante :
Comment les philosophes du 18ème siècle se représentent-ils le juge criminel ?
Cette question en amène une autre : Quelle fut l’influence de la représentation de la justice criminelle dans l’esprit des Révolutionnaires ?
Voici le sujet de ma thèse. Et celle-ci me semble à la fois passionnante et captivante car elle présente un savant mélange d’histoire du droit pénal, d’idées politiques, d’histoire de la Justice et des archives parlementaires.
D’une façon générale, le 18ème siècle est un siècle passionnant à tout point de vue : intellectuel, politique et judiciaire. D’un point de vue intellectuel d’abord car le 18ème siècle voit l’émergence d’un nouveau mouvement « Les Lumières », mouvement littéraire, philosophique et scientifique qui veut faire triompher la Raison.
D’un point de vue politique ensuite, le 18ème siècle est celui de la contestation et surtout il marque l’agonie de la monarchie absolue avec son incapacité à se réformer tant d’un point de vue institutionnel que d’un point de vue économique et fiscal.
Mais l’intérêt le plus fascinant du 18ème siècle se situe sans doute dans la sphère judiciaire. En effet, la Justice va être bourreau et complice de la monarchie absolue. Elle sera bourreau car les incessantes révoltes du monde judiciaire contre les tentatives de réformes du Roi Louis XVI seront un facteur déterminant dans la chute de l’Ancien Régime en 1789. Elle sera victime car elle est la branche qui symbolise le mieux l’incarnation du pouvoir royal. L’adage « Le Roi est fontaine de Justice » reste gravé dans les esprits du monde judiciaire du 18ème siècle.
Mon analyse repose dans un premier temps sur l’étude de trois auteurs. Montesquieu(A), Voltaire(B) puis Beccaria (C) présentent trois thèses complémentaires
Montesquieu ou la représentation nostalgique du juge criminel
Montesquieu est le premier à formuler des critiques à l’encontre de la procédure criminelle française, dans son ouvrage « De l’Esprit des lois », paru anonymement en 1748. Dans cet ouvrage, il se livre à des réflexions intéressantes car il estime que « le juge n’est que la bouche de la loi ». Il marque également son opposition à la torture et dresse une relative éloge de la procédure criminelle anglaise, qui s’inscrit dans l’air du temps des Lumières. Il nourrit même le projet d’un juge indépendant, idée novatrice à une époque où « le Roi est fontaine de justice ».
Cependant, cette liberté de ton, novatrice pour l’époque, masque une vision plus aristocratique de la Justice de la part du juriste bordelais. En effet, le juge de Montesquieu est un juge qui sait faire contrepoids à la Monarchie mais qui sait également respecter la valeur clef du régime monarchique : l’honneur.
Pour appuyer son raisonnement, l’aristocrate bordelais choisit de consacrer de longues pages élogieuses au droit féodal français, dans « l’Esprit des Lois ».
C’est ici que se situe l’ambiguïté de Montesquieu : Il est à la fois moderne pour son époque, en condamnant la torture et les châtiments corporels, ainsi qu’en mettant en place la théorie de la séparation des trois pouvoirs ; il est conservateur car il semble considérer que la Monarchie était « mieux avant », surtout à l’époque médiévale.
Un autre philosophe des Lumières, qui suit chronologiquement Montesquieu, sut se montrer beaucoup plus communicant et surtout polémiste.
Voltaire ou le polémiste à tout prix
Voltaire est sans doute le philosophe des Lumières le plus connu, en grande partie grâce à ses interventions dans les procès célèbres de l’époque, à savoir l’affaire Calas, l’affaire Sirven et l’affaire du chevalier de La Barre. Ses interventions ont permis au patriarche de Ferney d’acquérir une popularité immense en raison de son combat contre la justice criminelle de son époque. La gloire politique supplante la gloire littéraire chez Voltaire, mais, paradoxalement, il ne fut pas un grand théoricien des idées politiques, à l’inverse de son éternel rival Jean Jacques Rousseau.
En effet, le patriarche de Ferney est ce qu’on appellerait aujourd’hui un « polémiste communicant ». Son objectif n’est pas de promouvoir une réflexion de fond mais de s’attaquer frontalement à la Justice, en prenant pour base des procès dignes des grandes erreurs judiciaires. Ce que cherche Voltaire avant tout, c’est l’appui massif de l’opinion publique. À l’inverse de Montesquieu, il n’est pas juriste et s’est formé de manière très succincte au droit pénal anglais de l’époque, qui était assez en vogue puisque considéré comme plus respectueux des accusés, en raison de la procédure pénale.
Cependant, Voltaire, à travers sa formation succincte au droit anglais, va s’enthousiasmer pour une institution typique de la Common Law : le double jury criminel. Le premier jury criminel est le jury d’accusation qui est chargé d’étudier le bien fondé des poursuites judiciaires.
Le second jury étant le jury de jugement qui se prononce sur la culpabilité de l’accusé. Il semble que ce qui séduisit le philosophe ce fut l’aspect démocratique de cette organisation, puisque les jurés sont des citoyens et non des magistrats professionnels du droit.
En réalité, ce qui intéresse l’auteur de « Candide », c’est de lutter contre le fanatisme religieux en alertant l’opinion publique sur les dangers de celui-ci. D’où le choix de Voltaire de s’impliquer activement dans les procès pénaux à forte connotation religieuse, puisque les Calas et les Sirven étaient protestants, le chevalier de La Barre quant à lui était catholique mais fut accusé de blasphème, infraction religieuse grave pour l’époque, puisque punie de la peine capitale .
Le juge étant la cible la plus facile et la plus symbolique, car le juge reste la branche la plus régalienne du pouvoir royal au 18ème siècle. Pour Voltaire, attaquer le politique constitue une arme de choix pour décocher une flèche acérée à l’encontre de la religion.
Toutefois, il sut contribuer fortement à éveiller les consciences sur les limites de la procédure criminelle inquisitoire française et promouvoir les bienfaits de la procédure criminelle accusatoire anglaise, qui bénéficie à cette époque d’un vif regain d’intérêt.
Si Voltaire marqua son époque par ses prises de positions et polémiques, un dernier intellectuel, chronologiquement parlant, doit être abordé car il va révolutionner l’approche pénale.
La Révolution pénale ou l’approche de Beccaria
Le « traité des délits et des peines » de Beccaria, paru en 1766, marque un renouveau dans le mouvement des Lumières. En effet, à partir de la parution de ce traité, un engouement va se créer en faveur des idées réformatrices des Lumières. L’innovation de Beccaria est de proposer un système alternatif à celui de la peine expiatoire qui se pratique sous l’Ancien Régime. En effet, le marquis milanais ne fait pas que manifester son opposition à la torture et aux châtiments corporels qui sont les clés de voute du système pénal des peines expiatoires, il est le précurseur de la pénologie moderne avec ses thèses selon lesquelles il faut des peines douces et proportionnées, des peines également utiles au condamné et surtout des peines strictement définies par la loi.
Le juge ne doit bénéficier d’aucune marge de manœuvre dans le prononcé d’une peine pénale que ce soit pour l’atténuer ou pour l’aggraver.
Ainsi Beccaria, économiste milanais, apporte une nouvelle représentation dans la vision du juge criminel. Cette vision est une vision de subordination, puisque le juge ne fait qu’appliquer la loi. En ce sens, Beccaria rejoint Montesquieu, qui estime que « le juge n’est que la bouche de la loi ».
L’influence du marquis du duché de Milan fut considérable et pose les bases du droit pénal moderne. Néanmoins, il eut aussi ses opposants, parmi lesquels se trouvent certains juristes français qui ne souhaitent pas remettre en cause la sévérité de l’Ordonnance Criminelle. Le plus connu d’entre eux est sans doute Muyart de Vouglans, avec son Contre –Traité des délits et des peines, au sein duquel il expose sa vision extrêmement conservatrice en matière de procédure criminelle.
Si le marquis milanais séduisit certains de ses contemporains, Voltaire en premier, son influence ne s’arrêta pas à sa mort et gagna l’ensemble des révolutionnaires de 1789.