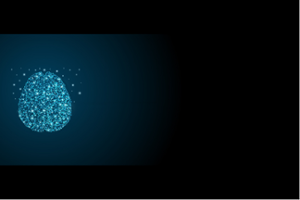Le petit écran propose des mises à jour régulières des héros de la littérature. Au fil des ans, Sherlock Holmes a ainsi troqué son flegme contre des tics de junkie. Arraché à son époque, il a glissé dans des rues londoniennes surplombées de gratte-ciels, a perdu sa loupe en chemin, découvert le smartphone et crée un compte sur twitter. Plus généralement, le rythme des séries télévisées semble avec une insistance croissante reproduire celui donné par le numérique. Celui-ci impose aux images sa ligne de temps et sa logique. Partant de là, il est légitime pour le spectateur de s’interroger. Le 7e art a-t-il vocation à assimiler les mutations sociales contemporaines ? Ou ne peut-il simplement pas y échapper ? Et si le numérique transforme les usages et les schémas cognitifs, tous les champs artistiques s’en trouvent-ils bousculés ?
Julien Bouillon et Christian Vialard, tous deux artistes, enseignent à l’école supérieure d’art de la Villa Arson, membre d’Université Côte d’Azur. Chacun a débuté sa carrière à un moment charnière de la révolution numérique. Le premier obtient son diplôme à la fin des années 90, alors que le téléphone portable (pas encore « intelligent ») envahit les foyers. Les lectures de Gilbert Simondon et de Jacques Ellul, mais aussi des romans de science-fiction, le poussent à creuser la problématique de la technique. Pour lui, le numérique et ses « créatures » consistent en des sujets à questionner, qu’il est possible de mettre à distance avec humour. « J’aime jouer avec les limites des systèmes. Je tourne la machine en dérision en montrant comment elle s’enferme sur elle-même », raconte Julien Bouillon.
Il expérimente par exemple une utilisation « outrancière » de la synthèse automatique de word. « À l’aide de Gallica, j’ai soumis au logiciel des oeuvres entières de Balzac et de Lacan. Je les réduisais à quelques dizaines de lignes et cela créait des Haikus absolument incroyables, des livres de poésie automatique extraordinaires », se souvient l’artiste. Un peu plus tôt, il utilisait les scripts de Photoshop pour traiter les images en boucle sans interruption. Dans un « hommage à Joseph Albers », son dispositif génère dans une vidéo de trois minutes des variations de carrés de couleurs et évoque au passage l’industrialisation et la robotisation du travail.
« On met en place un processus, une forme entre dans le système et le résultat peut s’avérer très curieux »
Avec ses « dispositifs dépassés », des peintures et des sculptures de pseudo smartphones, Julien Bouillon met en scène un design qui n’aurait pas abouti car trop inadapté à son usage. « Mon idée est que la peinture est un dispositif au même titre que le téléphone. En d’autres termes, le dispositif est constitué de dit (les discours) et de non-dit (les peintures, par exemple). Le dispositif est aussi le réseau établi entre ces différents éléments. Le dispositif (Peinture/Téléphone) “capte” et “conduit” le regardeur/usager, si vous voulez” », commente-t-il. Aujourd’hui, il rapproche le deep learning de l’OUvroir de Littérature Potentielle : « On met en place un processus, une forme entre dans le système et le résultat peut s’avérer très curieux ». « Mais le numérique amène aussi des questions dont on peut s’inquiéter, comme la disparition possible du travail », souligne Julien Bouillon.
Pour le Professeur Paul Rasse (1), chercheur en Sciences de l’Information et de la Communication au laboratoire sic.Lab Méditerranée, « dans un monde où le travail industriel est en déclin au bénéfice des services, l’art apparait comme une perspective acceptable d’activité non marchande ». Selon lui, un nombre grandissant d’étudiants et de travailleurs en difficulté souhaiterait ainsi exercer une pratique artistique, au moins pendant un temps de sa vie. Or, les écoles d’art ont pour ainsi dire « toujours » présenté une alternative à un public ne trouvant pas sa place dans les filières plus « classiques ». Elles repêchaient alors les individus fâchés par exemple avec le système d’enseignement. La numérisation du travail accentuera peut-être ce phénomène dans des proportions inédites.
Néanmoins, il ne semble pas que les étudiants en art de la Villa Arson nourrissent à ce jour une « angoisse du numérique ». Julien Bouillon constate chez eux « un usage intensif des réseaux sociaux, d’Instagram, qui crée une circulation des travaux inédite et assez peu théorisée par les utilisateurs ». « Ils manifestent une culture de la rapidité et du zapping. Ils présentent des œuvres très fragmentées, des bouts d’images, des résonances, des choses qui pourraient fonctionner à la façon des hyperliens », souligne l’enseignant.
« Le numérique est un médium qui demande beaucoup d’investissement »
Son collègue Christian Vialard observe, dans les travaux d’étudiants, « la marque de l’accumulation, le recours à des penseurs hors sérail, le signe du bricolage intellectuel à partir d’extraits mis bout à bout ». Il constate également que le téléphone portable joue clairement pour eux le rôle de « mémoire ». En revanche, il ne relève pas plus d’habilités vis à vis des outils. « Ça leur parait naturel d’avoir une action sur des objets connectés mais ils n’imaginent pas s’en saisir pour l’intégrer dans des pièces d’art », raconte-t-il encore. Or, cet autodidacte le sait, « le numérique est un médium qui demande beaucoup d’investissement. Il faut apprendre à coder, à programmer, à souder des composants, à utiliser des capteurs et des petits moteurs… ». Rien de très intuitif. Mais pour motiver ses étudiants, depuis trois ans Christian Vialard organise des séminaires-projets en ERASMUS, avec « Arts au carré », l’École supérieure des Arts de Mons et le festival international des arts sonores, « city sonic ».
Lui-même musicien, plasticien sonore, dessinateur, il sait néanmoins que les galeries restent largement hermétiques à l’art numérique. « On ne le fait pas entrer. La technicité donne sans doute le sentiment que les artistes numériques seraient « moins artistes » que les autres ». Car le numérique mal compris peut donner l’illusion d’avoir déchargé l’artiste de son talent. Même si Julien Bouillon insiste sur le fait qu’une oeuvre n’existe pas sans commentaire, s’il est attaché au poids du métatexte, du regard de son auteur, le numérique a introduit un doute. Le développement des modes automatiques et des filtres artistiques, en photographie notamment, peut donner le sentiment à chacun qu’il est en mesure de « faire de la photo ».
« Faire un carré blanc sur fond blanc en 1918, ce n’est pas la même chose que le faire aujourd’hui. Cependant nous assistons à une simplification qui renverse les choses. Le talent n’est plus là où il était. Celui qui sait faire de beaux dessins, de la peinture figurative, ne peut plus se distinguer », estime Paul Rasse. Le numérique modifie ainsi l’expérience artistique mais également le rapport du public au musée. « Internet, au 20e siècle, se substitue au musée en tant que panoptique », explique le Pr. Rasse. Autrement dit, le numérique génère un nouveau lieu « d’où on peut embrasser du regard tous les savoirs ». Toutefois, selon le chercheur, si le Web permet désormais de préparer et de prolonger la visite des salles d’exposition, il ne se substitue pas à l’expérience artistique.
« Le lieu sacré de l’original »
Même si Google, avec son projet Arts et Culture, propose une visite virtuelle de musées et la découverte de milliers d’œuvres de maîtres, « l’exposition aux images, au lieu de l’assouvir, stimule le désir », estime Paul Rasse. « Alors même que l’essentiel d’une collection n’est jamais montré, le musée demeure le lieu sacré de l’original », analyse-t-il. « Les retransmissions sur écran d’opéras, de ballets, de pièces de théâtre, les copies en haute définition de toiles de maîtres entretiennent le rêve de passer du côté des VIP, devenu la scène « réelle » », poursuit le spécialiste. L’expérience artistique « directe » aurait ainsi un goût de luxe.
Pourtant, dans les années 80, l’ouverture spatio-temporelle que propose Internet crée des situations artistiques inespérées. Christian Vialard, alors tout juste sorti de la Villa Arson, assiste à une révolution. « Soudain, sont apparus des outils pour travailler en groupe sans être au même endroit », se souvient-il. Trente ans après, il orchestre « Asymphonie Monoton Silence », une installation composée d’un film projeté et d’une composition sonore. Il y met en scène 18 musiciens, resté chacun dans son studio à Berlin, Nice, Bordeaux ou Paris mais réunis dans des conditions de « live ». Par la suite, il s’intéresse à la puissance de calcul des ordinateurs. Et quand se développe la musique assistée par ordinateur, il choisit son instrument, la guitare.
Aujourd’hui, il peint et dessine aussi, mais l’essentiel de sa vie artistique se partage entre deux rôles. Celui de musicien et celui de plasticien du son. « La musique c’est beaucoup de mathématiques », insiste-t-il. « Par exemple, les compositeurs, tout de suite après la fin du 19e siècle, se sont intéressés aux intervalles de ton plus petits que ceux permis par les instruments. Ils ont ainsi cherché à créer des outils permettant d’améliorer la musique, dans le sens où ils donneraient plus de liberté au musicien », explique Christian Vialard. Pour sa part, il s’intéresse de près à la façon dont le numérique peut transformer le geste de l’artiste, an allant au-delà de l’instrument physique. Mais cela vaut également pour le dessin ou la sculpture, notamment par le biais de capteurs capables de « capturer le mouvement » (motion capture).
Dépasser les limites de l’instrument physique
C’est justement une des pistes expérimentées au Centre National de Création Musicale (CIRM), également membre d’Université Côte d’Azur. Son directeur, le compositeur François Paris, a testé en 2016 un outil inédit sur la création de son premier opéra, « Maria Republica ». « Je devais alors répondre à des contraintes particulières. Jouer des intervalles plus petits ou plus grands que les demi-tons de la gamme occidentale traditionnelle, impossibles à retranscrire sur un piano classique », raconte François Paris. Il compare ces explorations de différents tempéraments à des changements de plan au cinéma, du gros plan pour les tempéraments très resserrés (comportant les plus petits intervalles) au plan large comportant les intervalles les plus grands. « C’est comme ouvrir ou rétrécir un espace ». Or, dans les semaines qui précèdent les répétitions générales à l’opéra, le compositeur n’a avec lui qu’un piano avec les chanteurs, les musiciens de l’orchestre n’étant pas encore présents.
En collaboration avec deux autres membres d’UCA, la Sustainable Design School (SDS) et Inria, lui vient alors l’idée de réaliser un orchestre transitoire… et virtuel. Pour simuler l’orchestre au fil de l’écriture, un logiciel associe une partition disponible en « traitement de texte » avec des samples élaborés, tirés de banques de son, ces éléments étant reliés entre eux grâce à des plugins développés au CIRM. Dans sa version la plus sophistiquée, le logiciel permet de surcroît à la simulation de s’adapter aux variations de tempo du chef d’orchestre. Cette partie du travail s’appuie sur les recherches de Gerard Berry, médaille d’or du CNRS et titulaire au Collège de France de la chaire Algorithmes, machines et langages (langage Esterel), qui inspirera le programme « Antescofo » développé par Arshia Cont, directeur de recherche d’une équipe Inria/CNRS/Ircam.
Mais si Antescofo est tout à fait capable de suivre un chanteur ou un musicien en train d’émettre du son, il est plus difficile pour lui de suivre les gestes d’un chef d’orchestre, seul « patron » à l’opéra. Pour lancer ce « karaoké intelligent », un chef de chant doit donc suivre les mouvements du chef d’orchestre et transmettre les battues à l’ordinateur, qui « apprend » son tempo et recalcule la partition en temps réel. « C’est formidable, mais cela demeure très fastidieux. Nous espérons un jour trouver la porte d’entrée vers un contact direct entre le chef d’orchestre et l’ordinateur », confie François Paris. Il s’agit donc d’un des aspects du projet de « bureau du compositeur », développé au sein d’UCA grâce à un financement IDEX de près de 100 000 €. La poursuite des travaux associés à ce projet de recherche permettra à terme de dépasser les limites matérielles de l’artiste, depuis la page blanche jusqu’à la simulation orchestrale à variation temporelle. Un prototype devrait être présenté en février 2019.
« Nous pourrons écrire des sons extérieurs, intégrer un son électronique à la partition ou simuler des situations acoustiques complexes », se réjouit François Paris. Certains phénomènes, dus à des chocs de fréquence, s’avèrent en effet très difficiles à anticiper à l’oreille humaine. Mais si le compositeur les voit apparaître dans la simulation, il saura indiquer aux musiciens où chercher à « attraper » le bon son. Le public, enfin, ne devrait pas se trouver en reste. Pour la journée UCA du prochain festival MANCA, les chercheurs et ingénieurs du CIRM ont imaginé un « sound painting 2.0 ». Le public, au lieu de reproduire des sons avec son corps en suivant le chef d’orchestre, pourra piocher dans une banque de sons depuis son smartphone et tester son intuition artistique en « live », dans un esprit contributif.
(1) Paul Rasse a publié en 2017 Le musée réinventé- Culture, patrimoine, médiation aux éditions CNRS
Événements à venir :
- Opéra Pinocchio, création mondiale ayant bénéficié de la simulation orchestrale développée par le CIRM, au Festival International d’Art Lyrique d’Aix-en-Provence ( 3,7,9,11,14,16 juillet 2017)
- Festival biennale de l’image en mouvement MOVIMENTA (27 octobre-17 novembre 2017)
- Festival de musique contemporaine MANCA (novembre-décembre 2017)
Laurie Chiara - UCA labs stories