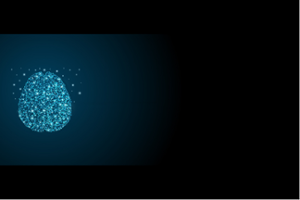le 14 mai 2020

Par le Professeur Dominique Torre, chercheur en économie au GREDEG
http://unice.fr/laboratoires/gredeg/membres/chercheurs-et-enseignants-chercheurs/torre-dominique
Les courbes de taux des principaux pays européens évoluent différemment depuis le début de la crise sanitaire. Celles de l’Espagne, de la Grèce et de l’Italie se déplacent vers le haut, celles de l’Allemagne, des Pays Bas, du Royaume Uni vers le bas, celles de la France et de la Belgique aussi, mais après un premier mouvement vers le haut. La plupart gardent leurs profils initiaux, normaux généralement, mais avec un peu plus d’irrégularités dans la partie courte pour l’Allemagne et une accentuation de l’inversion dans la partie longue pour celle du Royaume Uni (cf. figure 1).
Figure 1 : Evolution des taux souverains de 8 pays européens depuis le début de la crise sanitaire
Taux souverains et courbe de taux :
On appelle « taux souverains » les taux de rendement des emprunts d’Etat (souverains) échangés entre le moment de leur émission et celui de leur échéance. Ces taux de rendement sont en quelque sorte ce que rapportent ces emprunts quand on compare leur prix sur le marché aux revenus qu’ils engendrent avant leur échéance. Chaque « souverain » a sa propre courbe de taux. Celle-ci met en rapport en abscisse l’échéance, et en ordonnée le rendement.
Une courbe de taux se déplace vers le haut quand ce que les emprunts rapportent doit être plus grand pour que l’on accepte de les détenir. Une plus grande confiance déplace donc la courbe vers le bas et réciproquement.
Si l’on compare ces courbes avec celles des principaux émetteurs souverains hors Europe, on constate que les courbes des Etats Unis, de la Chine et du Canada se déplacent aussi vers le bas en gardant leur profil normal. Seule celle du Japon connait un léger déplacement vers le haut (cf. figure 2).
Figure 2 : Evolution des taux souverains des principaux émetteurs non-européens et part relative des émetteurs mondiaux
Ces observations n’ont pas attiré l’attention des commentateurs. Elles témoignent cependant d’une première constatation. Les plus gros émetteurs mondiaux (voir figure 2), le Japon – dans une faible mesure – mis à part, ne suscitent pas d’inquiétude particulière de la part des marchés. On y lit en effet deux choses d’un point de vue global.
1. Les grandes banques centrales (Federal Reserve, BCE, Banque d’Angleterre) ont émis des messages suffisamment clairs expliquant qu’elles apporteraient la liquidité au marché, quitte à remettre à plus tard le processus de réduction de la taille de leur bilan, laborieusement entrepris depuis quelques mois.
2. Les Etats les plus endettés font pour l’instant l’objet d’une confiance suffisante des marchés : le contraire se serait soldé par un redressement de la courbe, avec des primes de risque augmentant sur le long terme en même temps que les banques centrales desserraient le peu d’étreinte qu’elles essayaient de maintenir sur le court terme.
Ces deux observations ne sont d’ailleurs pas totalement indépendantes. Les engagements des instituts d’émission engendrent la confiance des marchés sur la soutenabilité de dettes publiques qui s’alourdiront pourtant, consécutivement à l’effet de ciseaux créé par l’accroissement des dépenses budgétaires liées aux aides et aux plans de relance d’un côté, et à la diminution des recettes fiscales liée au fort ralentissement de l’activité de l’autre.
Cet optimisme des marchés ne se manifeste cependant pas de façon uniforme. Il ne couvre pas tous les pays de la zone Euro alors qu’il semble particulièrement marqué au Royaume Uni et à la partie longue de sa courbe, celle qui est dominée par le poids des Etats et par les anticipations de longue période.
Il est un peu tôt pour analyser ces phénomènes de façon totalement rigoureuse. On peut cependant envisager quelques hypothèses et les discuter. Nous en retiendrons 5 : (i) les différences observées au niveau de l’effet de la pandémie et de sa gestion par les états pourraient expliquer des écarts d’évolution de taux ; (ii) le niveau des émissions publiques nouvelles annoncées en liaison avec les opérations de soutien et de relance des économies pourrait en être la cause ; (iii) le niveau de la dette existante qui mesure en partie la soutenabilité de son accroissement peut avoir un rôle à jouer ; (iv) l’indépendance financière des états qui est l’autre élément essentiel de la soutenabilité de l’accroissement de la dette peut être moteur de ces divergences, (v) enfin, les incertitudes à moyen/long terme relatives à l’évolution de l’activité économique sont aussi à considérer.
Tous les morts ne se valent pas
Les incidences humaines de la pandémie se lisent en Figure 3. Lorsque l’on rapporte le nombre de décès aux habitants, 6 des 8 pays analysés (Belgique, Espagne, Italie, Royaume Uni, France, Pays-Bas) sont pour l’instant les plus touchés au monde par la pandémie. L’Allemagne est plus faiblement affectée et la Grèce presque épargnée, au point de ne pas figurer dans les 31 pays les plus concernés et représentés par la figure 4 (qui exclut cependant les pays dont les données sont jugées peu fiables ou mal collectées). Quant à la gestion de la crise, les observateurs s’accordent à considérer que l’Allemagne a été à la fois prévoyante et judicieuse dans ses décisions en début d’épidémie, que le Royaume Uni a changé d’attitude en cours de route après avoir opté dans un premier temps pour la désastreuse stratégie de recherche d’une immunité collective, que l’Italie et l’Espagne ont pratiqué après quelques hésitations un confinement assez sévère et précoce qui a sans doute sauvé beaucoup de vies, que la Belgique et surtout la France ont eu plus de mal mais ont aussi pu aplatir le (premier ?) pic de la pandémie, que la Grèce et les Pays Bas se sont contentés de dispositifs moins lourds et contraignants, avec cependant des résultats meilleurs que leurs voisins.
Figure 3 : Incidences humaines de la pandémie par pays au 4 mai 2020.
S’il fallait s’en tenir à l’incidence humaine de la pandémie, ces observations devraient mettre la Belgique, l’Espagne, l’Italie est le Royaume Uni dans le même groupe. Or il n’en est rien : pour deux d’entre eux, la courbe des taux atteste d’un accroissement de l’inquiétude des investisseurs, et pour les deux autres un regain de confiance. Si l’on regarde la réactivité des états, c’est encore pire : le Royaume Uni – peu inspiré pendant les premières semaines – accroît son capital confiance, alors que l’Espagne et l’Italie, plutôt réactifs, sont sanctionnés sur le plan des anticipations.
A l’évidence, les morts ne se valent pas. Les bilans sanitaires provisoires de la pandémie et leur gestion par les états ne semblent pas expliquer les différences observées dans les évolutions des courbes des taux.
Parler ne sert à rien
On peut alors s’intéresser aux effets différés qu’auront les émissions supplémentaires des états sur le marché obligataire. Ces émissions seront liées à plusieurs facteurs :
(i) L’accroissement imprévu des dépenses budgétaires liées au financement des aides apportées aux chômeurs, aux entreprises en difficulté, puis aux dispositifs de relance de l’activité économique, à la réalisation éventuelle de nouveaux efforts en faveur d’une économie propre, d’une relocalisation de certaines activités, d’une acquisition de marges de manœuvres dans le domaine de la santé publique, etc…
(ii) La diminution des recettes fiscales liée au ralentissement de l’activité économique et à l’effet d’exonérations ou de reports de charges fiscales diverses.
Ces éléments sont difficiles à comptabiliser aujourd’hui : on peut cependant prêter oreille aux annonces des administrations des 8 pays concernés (cf. tableau 1). Leur fiabilité n’est bien sûr pas totale, les économistes appréciant peu le « déclaratif », même lorsqu’il s’agit d’administrations publiques. Mais que gagneraient-elles à mentir trop ? Les chiffres annoncés sont déjà très importants, et vont bien au-delà des 2,5% du PIB de déficit public qui constituent la norme européenne. Bien entendu les pays les plus touchés au niveau sanitaire (la Belgique, l’Espagne, le Royaume Uni, l’Italie) annoncent des déficits budgétaires importants, mais les autres aussi, ce qui semble indiquer que les états tablent sur des effets négatifs induits plus importants dans certains cas que les effets directs, les cas de la Grèce, voire de l’Allemagne étant particulièrement illustratifs.
Tableau 1 : Déficits 2020 annoncés et dette publique avant la crise
|
Pays |
Déficits publics / PIB 2020 annoncés |
Dette / PIB actuel |
|
Allemagne |
7% |
59,8% |
|
Belgique |
7,5% |
98,6% |
|
Espagne |
10,34% |
95,5% |
|
France |
9% |
98,1% |
|
Grèce |
9,9% |
177% |
|
Italie |
10,4% |
135% |
|
Pays-Bas |
7,3% |
48,6% |
|
Royaume Uni |
13,9% |
80,8% |
Toujours en première analyse, les annonces d’évolution des déficits publics, et donc d’accroissement absolu de la dette et d’évolution des émissions nouvelles, ne semblent donc pas expliquer les différences observées au niveau des courbes de taux. S’il en était ainsi (et si les annonces sont crédibles), c’est la courbe des taux du Royaume Uni qui devrait se déplacer le plus vers le haut. Or c’est strictement l’inverse que l’on observe. De même, aucune différence fondamentale ne devrait être observée entre les courbes des taux française et grecque.
Le passé ne s’oublie pas
On peut rechercher alors l’explication des déplacements asymétriques des courbes de taux liées dans la plus ou moins forte soutenabilité de l’effort public. Les dettes publiques européennes sont de niveau très différent quand on les rapporte au PIB et leur trajectoire diffère aussi. Le tableau 1 rapporte dans sa dernière colonne le niveau de la dette estimée par rapport au PIB dans chacun des 8 pays considérés. Les pays les moins endettés sont les Pays Bas et l’Allemagne et les plus endettés sont la Grèce et l’Italie. Au milieu se trouvent tous les autres, en particulier la France, la Belgique et l’Espagne, dont les mauvaises performances sont voisines, et le Royaume Uni, un peu mieux placé. La trajectoire que nous n’avons pas documentée aggrave ces disparités. Ces dernières années les pays les moins endettés ont aussi eu tendance à se désendetter et les plus endettés ont du mal à améliorer leurs performances, y compris en situation de croissance, et malgré dans certains cas l’expression d’un excédent primaire.
La dette publique en elle-même intègre déjà le passé des émetteurs, parfois lointain. Si l’on compare les chiffres de la colonne de droite du tableau 1 et la forme des courbes, on voir alors apparaitre une première relation assez claire : celle-ci fait des pays les plus endettés des candidats naturels à des faiblesses sur le marché obligataire ces derniers mois. La Grèce et l’Italie sont les plus endettés : les tensions se manifestent pour ces deux émetteurs, par ailleurs très diversement affectés par la crise sanitaire. Mais juste après viennent la Belgique et la France pour lesquels les marchés ne manifestent pas d’inquiétude, alors que l’Espagne, bon élève du désendettement, se voit pénalisée malgré ses performances récentes en matière de désendettement, quand la Belgique ou la France s’en sortent mieux sur les marchés. Si le niveau de la dette publique semble donner des indications non-négligeables sur les anticipations des marchés, ce ne semble donc pas la seule explication des divergences qu’attestent les courbes des taux souverains européens.
On peut dépenser l’argent des autres…
Les économistes qualifient de « péché originel » le fait de ne pas pouvoir s’endetter dans sa propre monnaie. Cette marque d’infamie frappe la plupart des pays en développement qui optent pour une indépendance monétaire et donc pour une imprévisibilité de leur taux de change. Pour ceux qui optent pour la dépendance -- et donc la fixité du change --, ce n’est pas beaucoup mieux : ils s’exposent à de graves crises de change comme nous l’ont appris les crises mexicaines et asiatiques à la fin des années 1990. En définitive, il leur faut soit renoncer à la dette soit à leur autonomie monétaire. En Europe, rien de tel, nous avons l’Euro qui sert de base à la plupart des émissions obligataires. Mais un autre péché existe, plus pernicieux que le précédent, c’est le fait pour certains états de ne pouvoir emprunter à leurs propres compatriotes, c’est de dépendre de l’extérieur.
Qui détient ou non sa propre dette ?
Il y a plusieurs raisons de détenir ou non sa propre dette. En premier lieu, les pays très pauvres n’ont généralement pas les épargnants nécessaires pour que leurs nationaux achètent des emprunts d’Etat. A l’autre extrême, la dette de certains pays comme l’Allemagne, voire la France, est très appréciée parce que ces Etats n’ont pas fait défaut depuis plusieurs centaines d’années parfois (la France a fait défaut la dernière fois sous le directoire). La dette américaine est aussi appréciée, notamment par certains de ses partenaires commerciaux comme la Chine parce que c’est une manière de s’assurer de manière indirecte une compétitivité de ses exportations. On peut aussi détenir de la dette étrangère pour « diversifier » un portefeuille : les grandes banques ne se spécialisent pas dans la détention de la dette d’un seul pays mais détiennent généralement des portefeuilles associant plusieurs types de dettes souveraines. On ne détient généralement pas la dette d’un pays dont on pense qu’il peut faire défaut, ou alors seulement si son rendement est très élevé. Pour cette raison, les pays pauvres ne peuvent généralement émettre de la dette autrement qu’auprès d’organismes internationaux, Banque Mondiale ou FMI qui acceptent de prendre le risque mais en contrepartie d’engagements, de surveillance, ou pour des objectifs bien précis.
La figure 5, fournie par Eurostat nous donne quelques indications sur ce péché-là : l’Italie et le Royaume Uni sont vertueux et seront vite pardonnés, l’Espagne et les Pays Bas devront faire contrition, la France, la Belgique et l’Allemagne auront un peu de mal à aller à confesse. Quant à la Grèce, elle détient tellement peu sa propre dette qu’elle ne figure pas dans ces chiffres (qui datent un peu il est vrai).
On voit que ce péché n’explique pas tout. Il marcherait pour la Grèce mais le fait que la dette allemande soit assez peu détenue par les nationaux n’a jamais constitué un handicap pour ce pays, bien au contraire. Aujourd’hui, la courbe des taux des Etats-Unis montre d’ailleurs une évolution très positive alors que ce pays dépend très largement de l’extérieur pour ses émissions obligataires.
Figure 4 : Part de la dette publique détenue par les résidents
… mais le pire, c’est de rester entre soi !
Les secteurs n’ont pas été et ne seront pas tous aussi affectés directement par la crise sanitaire. Le tourisme, les transports et l’aéronautique viennent en tête des secteurs appelés à souffrir durablement. D’autres seront épargnés, voire profiteront de la crise, comme l’industrie pharmaceutique ou le numérique. La figure 5 relève la part du tourisme dans le PIB pour les principaux pays concernés par cette activité. L’Espagne est en tête, la France, la Grèce et l’Italie ne sont pas loin. L’Allemagne et les Royaume Uni sont plus loin. De toutes les hypothèses candidates à expliquer la réaction différenciée des courbes de taux, celle-ci a l’air d’assez bien convenir.
Les trois pays du Sud de l’Europe, les pays Club Med comme on les avait appelés pendant la Crise de la Dette Souveraine, font effectivement l‘objet d’anticipations négatives. Les étrangers qui financent leurs emprunts doivent revenir chez eux comme ils en ont l’habitude pour que leurs économies survivent, mais les courbes des taux grecs, italiens et espagnols montrent qu’ils n’y sont pas disposés ou du moins qu’on ne leur en prête pas l’intention de voyager pour l’instant.
Si ces remarques tenaient pour ces trois-là, la France apparaitrait alors comme un paradoxe : les anticipations des marchés la voient encore comme émettrice d’une dette soutenable et attrayante, alors qu’elle sera très affectée par la diminution de l’activité touristique, et aura aussi des difficultés à maintenir à flot un secteur aéronautique qui compte tant dans ses exportations. Quelle est l’origine de ce capital confiance ? La propension de la France à prendre des initiatives politiques en Europe et dans le monde face à des leaders affaiblis, sa capacité à accélérer la transition écologique, ce qui reste de son modèle social ? Ou à court terme, un pari sur son habilité à lisser d’éventuelles nouvelles vagues épidémiques ?
Figure 5 : Part des recettes du tourisme dans le PIB